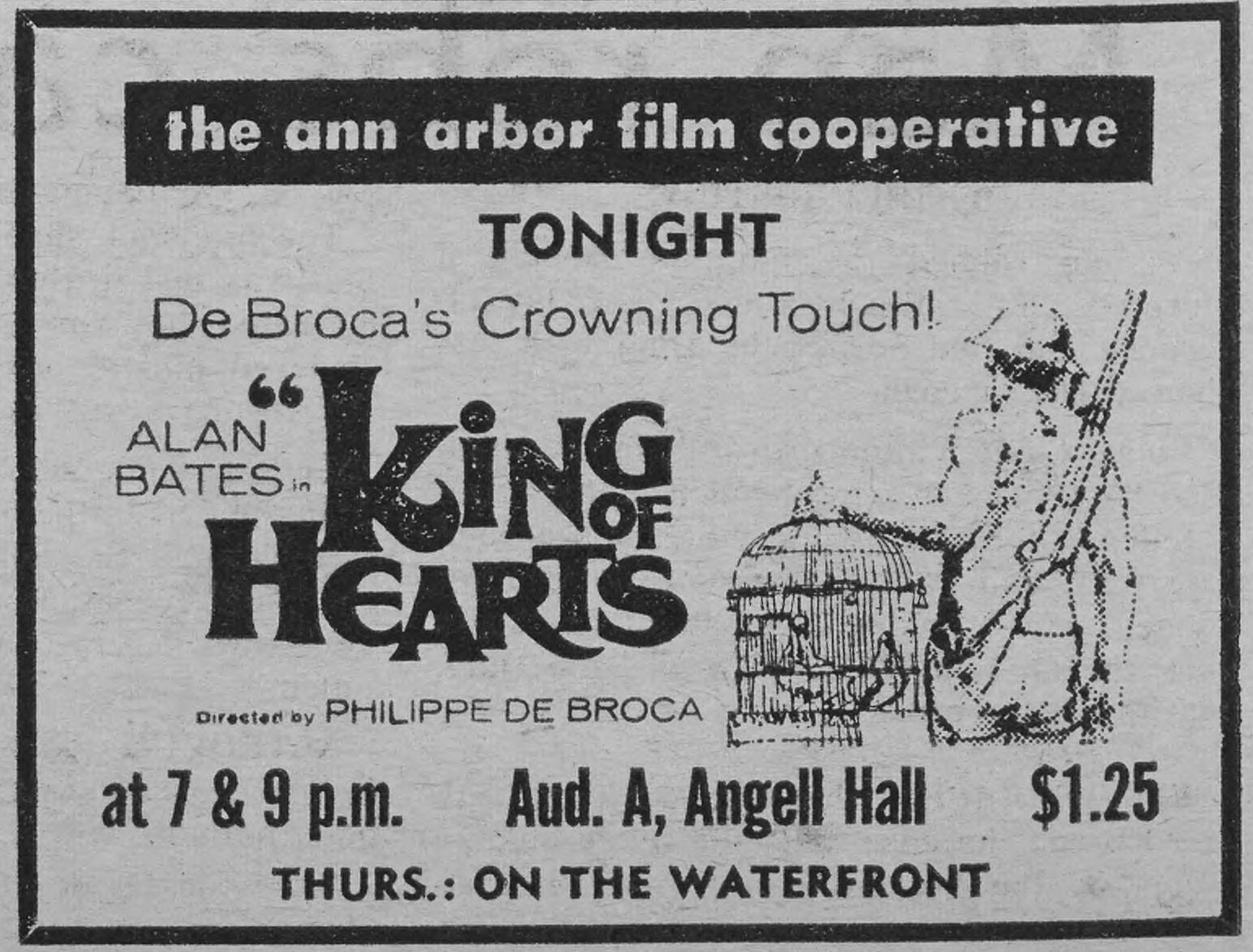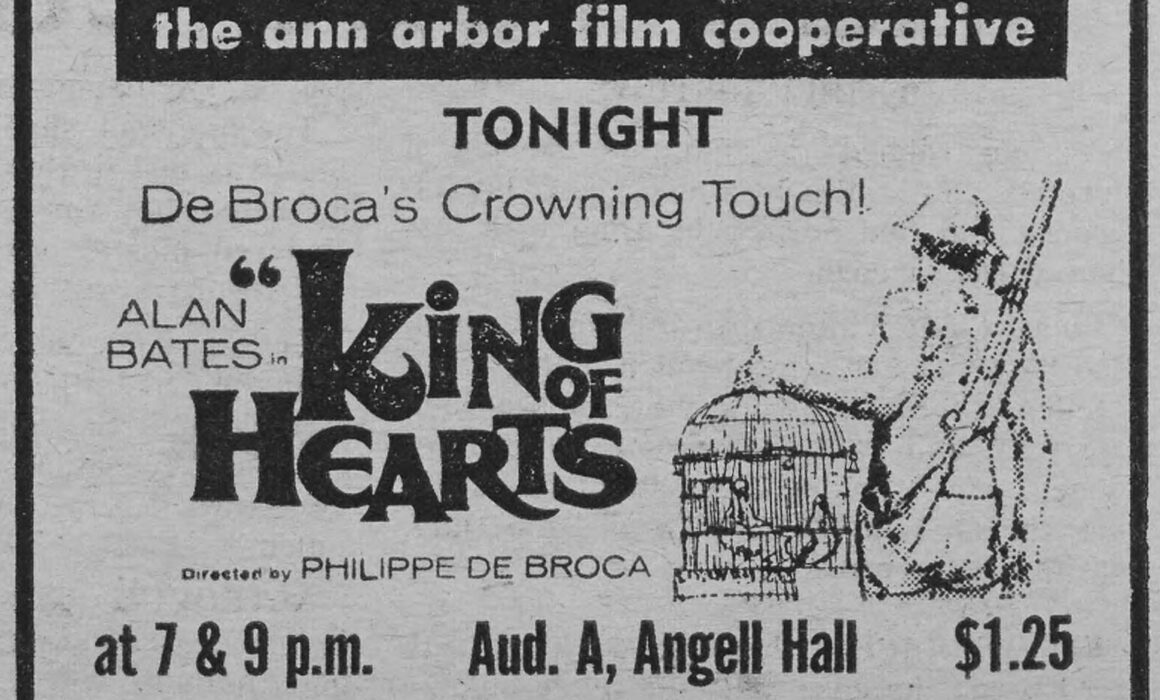« Le Roi de cœur », film culte sur les campus américains
« Le Roi de cœur »,
film culte sur les campus américains
En 1975, le Michigan Daily se penche sur le phénomène autour du « Roi de cœur » qui passionne les étudiants de l’université du Michigan à Ann Arbor.
« Bien que les Marx Brothers aient toujours eu beaucoup de succès à Ann Arbor et que L’Odyssée de l’African Queen et Casablanca semblent toujours figurer dans un programme cinématographique ou un autre, il n’y a qu’un seul film qui se démarque comme étant le plus populaire sur le campus, le seul qui puisse véritablement être qualifié de film culte ici. Ce film, c’est Le Roi de cœur. L’été dernier, un groupe cinématographique d’Ann Arbor a projeté Le Roi tous les mercredis pendant 12 semaines devant un public enthousiaste, faisant salle comble à plusieurs reprises et obtenant presque autant de succès à la fin de la série de projections qu’au début.
Réalisé par Philippe de Broca, figure de la Nouvelle Vague française, le film est sorti à Paris en 1966, mais a été un tel échec au box-office que le réalisateur a fermé la billetterie pour laisser entrer tout le monde gratuitement, sans pour autant attirer les spectateurs. En effet, malgré l’éminence actuelle du réalisateur dans le monde du cinéma, Le Roi de cœur reste inconnu dans son propre pays à ce jour. Aux États-Unis, cependant, en incarnant l’une des histoires les plus incroyables de réussite sociale dans le monde du cinéma, le film a rapporté sept fois plus d’argent lors de ses rééditions qu’il ne l’avait fait lors de toutes ses premières projections.
De Broca travaillait dans le cinéma depuis des années, en tant qu’assistant de François Truffaut dans Les Quatre Cents Coups et de Claude Chabrol dans trois autres films. Finalement, de Broca en a eu assez de travailler pour les autres et, selon ses propres mots, il a dit à Chabrol : « J’en ai marre d’aller chercher tes cigarettes. Je veux faire mon propre film. » Chabrol a accepté et est devenu le producteur de ses deux premiers films. La première américaine du Roi de cœur en 1967 ne fut guère différente de ce qui s’était passé en France, de nombreux critiques ayant descendu le film, y compris le magazine Time qui déclara à son sujet : « Rien dans cette comédie ne tient la route. »
Bien qu’il ait fait un flop dans la plupart du pays, il a très bien marché dans certaines villes, notamment à Ann Arbor où il a attiré un public nombreux au Campus Theater.
Sur le plan financier, cependant, ce fut un échec. Puis quelque chose d’étrange s’est produit. Le 11 février 1971, Le Roi de cœur a été ajouté en deuxième partie d’un programme double dans un petit cinéma d’art et d’essai près de l’université de Harvard. Quatre ans et demi plus tard, il est toujours à l’affiche, ce qui en fait le film le plus longtemps à l’affiche de l’histoire. Dans le film, Alan Bates incarne un soldat écossais envoyé dans une petite ville française, abandonnée par les troupes allemandes en retraite, pour désamorcer une énorme bombe qu’elles ont laissée derrière elles. Tous les habitants partent précipitamment, mais dans leur hâte, ils ont laissé derrière eux les pensionnaires d’un asile psychiatrique. En cherchant la bombe, Bates tombe par hasard dans le monde des pensionnaires et se retrouve roi de cœur, bientôt marié à la reine (Geneviève Bujold dans l’un de ses premiers rôles à l’écran). Le message est léger mais réfléchi, opposant le monde innocent et enfantin des fous à celui, autodestructeur, des gens civilisés et sains d’esprit. Bates se retrouve pris entre deux feux et doit faire un choix.
Un échantillon des personnes qui reviennent voir le film donne un aperçu de sa popularité. Une spectatrice, qui s’apprêtait à voir le film pour la quatrième fois, a déclaré : « J’adore ce film… il me donne l’impression qu’il y a de l’espoir dans le monde. » Une autre, qui le voyait pour la deuxième fois, l’a décrit comme « un film agréable et doux qui me rend très heureuse ». C’est la philosophie du film qui attire le public, comme l’ont fait d’autres films cultes ces dernières années, notamment Harold et Maude et les films Billy Jack. C’est le sentiment de célébration de la vie que Le Roi de cœur exprime qui rappelle la séquence suivante de Harold et Maude. Maude, âgée de 80 ans, dit au jeune Harold : « Tente ta chance. Prends des risques. Même si tu te blesses. Vas-y, fonce. Vis. Sinon, tu n’auras rien à raconter dans les vestiaires. » « Je ne veux pas mourir », dit le roi de cœur à la reine. « Personne ne connaît sa propre mort », répond-elle. « Il ne me reste que trois minutes à vivre », poursuit-il. « Trois minutes ! », répond-elle, les yeux brillants, « trois minutes, c’est génial ! »
Des sondages réalisés au Movie House de Seattle indiquent que la moitié du public a déjà vu le film et que la moitié d’entre eux l’ont vu au moins deux fois. À Cambridge, un fan l’a vu 86 fois. À Ann Arbor, cependant, un échantillon du public a révélé que seulement 10 % l’avaient déjà vu, ce qui prouve à la fois le roulement rapide des étudiants ici et le fait que de nombreux étudiants n’ont jamais pu voir le film auparavant en raison de sa distribution limitée. Souvent projeté sur le campus du Michigan, Le Roi de cœur vaut vraiment la peine d’y consacrer deux petites heures. »
« Cults flock to ’King of Hearts’ » de Jim Frisinger, The Michigan Daily, 9 octobre 1975.
L’article original est à lire ici.